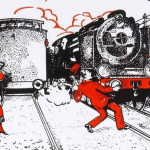Je trouve les témoignages d’adultes autistes tardivement diagnostiqués aussi passionnants qu’utiles ; j’ai l’impression qu’en plus de documenter des récits de vie et des parcours atypiques, ce qui est toujours précieux, ces témoignages constituent également pour pas mal d’adultes un outil spécifique de légitimation et de réconfort. Qu’on ait accès à ces mots-là avant, pendant ou après le diagnostic, ils sont une aide inestimable.
J’ai puisé et je puise encore, dans ces prises de parole, de précieux arguments pour expliquer quand je le souhaite, me défendre quand c’est nécessaire ou tout simplement me sentir moins seule sans pour autant devoir me contraindre à socialiser physiquement quand je n’en ai pas envie et ô surprise, j’en ai rarement envie.
Mais j’ai 52 ans. Et c’est là que le bât blesse. Car ce qu’on appelle aujourd’hui « diagnostic tardif », ce sont globalement les diagnostics délivrés à 20 ans, 25 ou 30 ans. Mais ça s’arrête à peu près là.
Et si j’ai envie (besoin ?) de ces témoignages-là, si je les trouve indispensables et d’utilité publique, je reste pour autant en décalage. Encore et toujours. En raison du TSA peut-être, mais plus spécifiquement parce que j’ai 52 ans. Et qu’en dépit de toute ma bonne volonté, le processus d’identification ne peut pas fonctionner et c’est bien normal. Je comprends, je lis et j’écoute, je « fais communauté », mais je m’identifie pas. De la même façon qu’une jeune femme de 30 ans ne s’identifiera pas forcément à moi.
Certes, le sentiment de perte, la tristesse, la colère, la frustration rétrospective, la certitude que j’aurais pu, que j’aurais dû avoir le droit de vivre mieux, d’exister vraiment, le soulagement, l’espoir, l’étau qui me broie à la pensée de tout qui m’a été volé et qu’on ne me rendra jamais, tout cela est probablement identique à ce que vivent et ressentent de jeunes femmes récemment diagnostiquées. Mais une chose diffère et me sépare, moi la vieille, des autistes plus jeunes, se dressant comme un mur de glace entre elles et moi : je vis tout cela en queue de peloton, abandonnée sur le bord d’un chemin pourri, poussiéreuse et usée par cinq décennies de souffrance silencieuse et de honte diffuse, d’être ce que je suis sans jamais avoir su ce que j’étais, à une époque étrangement moderne et pourtant aveugle.
Les années 80, c’était encore l’autisme de Kanner et d’Asperger, dont les troubles connexions nazies interpellent un tantinet, le tout sous domination de la psychanalyse, avec une mention spéciale pour les délires de Bettelheim.
Et pour nous, enfants des années 80 et jeunes adultes des années 90, l’autisme c’était Rain Man et quelques bouquins glauques, sous-produits culturels bien ancrés dans la conscience collective par la représentation caricaturale d’un petit garçon mutique, qu’on visualisait en train de se balancer sous une table, face au mur, comme pour tourner le dos à un monde qui de toute façon ne voulait pas de lui.
Autant dire qu’on partait de loin et que les femmes autistes de ma génération n’étaient pas encore nées à la bonne époque pour elles. Elles n’étaient ni éveillées ni outillées pour demander, attendre ou espérer quoi que ce soit en terme d’écoute, et ne parlons même pas d’une prise en charge.
Les femmes de ma génération sont en réalité une sous-catégorie de la génération perdue décrite par Lai et Baron-Cohen : tous ces gens nés entre les années 50 et les années 90, qui sont passés sous les radars diagnostiques de l’autisme et ont été diagnostiqués à tort bipolaires, schizophrènes, ont été mis sous traitement et parfois même internés dans des unités psychiatriques.
Je ne dis pas que le diagnostic tardif est plus dur à vivre à 50 ans qu’à 30, je dis juste que c’est différent, et c’est ok. On peut se soutenir les unes les autres sans avoir les mêmes vécus, et on se retrouve tout de même sur des dénominateurs communs directement liés au TSA, ce qui est déjà très réconfortant.
Mais j’ai besoin de résonnance. J’ai besoin d’entendre les voix des femmes qui comme moi ont grandi sous les strass des boules à facettes, testant in situ des libertés toutes neuves, grâce aux victoires encore fraîches des années 70. Des femmes qui comme moi se sont senties déconnectées de cette fête que furent les années 80 et 90. À la marge de tous les groupes, en peine de lier amitié, ou de la faire durer, observant un monde qui toujours semblait nous refouler à sa périphérie, telles de petits débris presque invisibles rejetés sur le sable par les vagues.
La certitude d’un monde moins merdique et de diagnostics précoces pour les générations futures me console un peu, mais j’ai encore envie d’un avenir, un qui soit vrai, qui soit palpable et qui soit mien. J’ai furieusement besoin de savoir qu’il se passe enfin quelque chose de réel, quelque chose qui nous permette de nous connecter à nous-mêmes, pour moi comme pour celles qui ont encaissé plus que leur part à des époques pourtant prometteuses pour les femmes, et qui ont vu leurs luttes inachevées balayées par un diagnostic dont elles ont découvert l’impact en même temps que le sens.
Je suis pleine de regrets, je déborde de chagrin, mais je n’ai jamais été aussi heureuse qu’aujourd’hui, et chaque heure qui passe me rapproche de moi-même. Je veux croire qu’il n’est pas trop tard pour être moi. Et je sais que je ne suis pas seule.
The Silencers – Bulletproof Heart
Some say this is a dangerous place
Dangerous women, lipstick mace
Men disappear without a trace
Stay anonymous, hide your face
In this town, you’d need a Bulletproof heart
In this town, you’d need a Bulletproof, shatterproof heart
When I came here, I was innocent
Soon found out what trouble meant
Now I regret the times I’ve spent
In your towerblocks and tenements
In this town you’d need a Bulletproof heart
In this town you’d need a Bulletproof, shatterproof heart
Watch your step
Don’t open your door
Watch your step
They want to settle a score